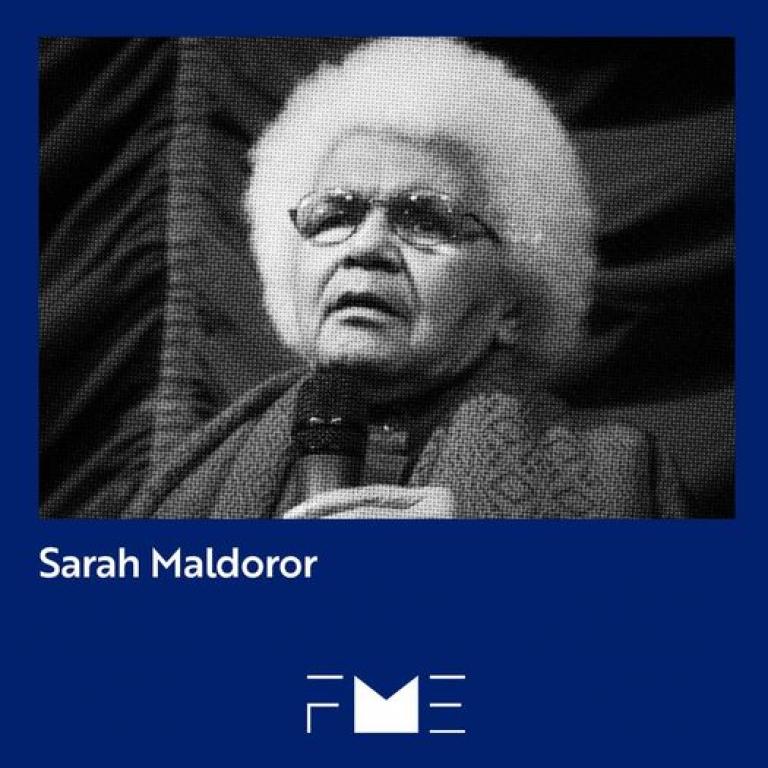Artiste, chanteuse, autrice, compositrice, interprète, comédienne haïtienne et militante des droits humains.
Connue sous son nom de scène de Toto Bissainthe, Marie-Clothilde Bissainthe est une figure emblématique de la culture haïtienne. Chanteuse, comédienne et militante, elle s’est battue toute sa vie pour dénoncer l'injustice subie par la population de son pays, Haïti, et défendre les droits humains.
Elle naît le 2 avril 1934 à Cap-Haïtien, dans une famille qui a eu à souffrir de l’occupation américaine d’Haïti, entre 1915 et 1934, année de sa naissance.
Après un premier séjour aux Etats-Unis, en 1953, elle s’installe à l’âge de 19 ans à Paris pour ses études. Elle y débute une carrière de comédienne, d’abord au théâtre en 1956 avec la pièce Le mariage de Fatou, écrite par Emile Cissé, qui sera suivie d’une tournée en Afrique. La même année, elle fonde avec le guadeloupéen Robert Liensol aux côtés de Sarah Maldoror, elle aussi d’origine guadeloupéenne, du Sénégalais Ababacar Samb Makharam et de l’Ivoirien Timité Bassori, la compagnie Les Griots, première troupe de théâtre constituée exclusivement de comédiennes et comédiens noirs. Elle remporte le 2e prix du concours national du théâtre universitaire en 1956 pour la pièce Huis clos, de Jean-Paul Sartre.
Dès 1957, la compagnie Les Griots entreprend la mise en scène et la production de quatre autres pièces, parmi lesquelles La fille des dieux, d’Abdou Ankara, mise en scène Roger Blin qui rejoint la troupe la même année, mais aussi L’ombre de la ravine, de Synge, ou encore L’invité de Pierre d’Alexandre Pouchkine. En 1959 elle fait partie de la distribution de la création de la pièce de Jean Genet Les Nègres.
Sa première apparition au cinéma en 1959 fait scandale : dans Les Tripes au Soleil, Claude Bernard Aubert représente l’un des premiers baisers entre un homme blanc et une femme noire dans un film. Elle joue ensuite pour les grands réalisateurs qui ont représenté les diasporas afro-descendantes au cinéma : le sénégalais Ousmane Sembène en 1966 avec La Noire de..., l’haïtien Raoul Peck en 1991 avec L’Homme sur les quais, et le franco-mauritanien Med Hondo en 1979 avec West Indies ou les nègres marrons de la liberté. Dans ce film, elle se confronte à la mémoire de l’esclavage, un sujet qui la hantera toute sa vie et qu’elle retrouvera sur l’île de Gorée, au Sénégal, lieu de passage des esclaves vers les Antilles dans le cadre de la traite esclavagiste, dont la visite restera un événement qui la marquera profondément.
Dans les années 1960, elle s’impose également comme chanteuse : inspirée par la spiritualité et les traditions paysannes haïtiennes, elle sort en 1966 un album en collaboration avec Le Ferdinand Dor Jazz Quartet. Mêlant airs haïtiens, influences vaudou et musique classique française, ce disque devient pour elle un moyen pour défendre et diffuser la culture caribéenne au-delà des frontières, notamment en Europe.
La carrière musicale de Toto Bissainthe la conduit à voyager dans le monde entier, par de nombreuses tournées en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Europe. Elle fait appel à d’autres chanteuses pour son groupe comme Mariann Mathéus ou Marie-Claude Benoit. Pour Toto Bissainthe, chanter des musiques inspirées du culte vaudou, c’est faire entendre la voix des oubliés, des esclaves et de leurs descendants. C’est rendre hommage à leur résistance et à leurs combats. C’est rappeler qu’en se révoltant à Haïti ils ont éclairé le monde.
Son engagement pour le peuple haïtien est aussi pour elle une occasion de dénoncer les crimes commis par la dictature de François Duvalier dit « Papa Doc », arrivé au pouvoir à Haïti en 1957 et qui s’est proclamé président à vie en 1964, puis de son fils Jean-Claude Duvalier, dit « Bébé Doc », qui font régner la terreur dans le pays. Exilée loin de chez elle, elle ne pourra revenir en Haïti qu’en 1986, après la chute de J-C Duvalier.
Toto Bissainthe s’éteint le 4 juin 1994 à Pétion-Ville, dans son pays natal qu’elle avait chéri et défendu tout au long de sa vie, à travers ses chansons et ses rôles. Sa carrière, riche et diverse, continue d’influencer les générations actuelles, tant par son art que par son engagement pour les droits humains et la culture de son pays, Haïti.
Sources d'informations
- Site officiel consacré à Toto Bissainthe
- La chanteuse Toto Bissainthe, une icône de la résistance à l’oppression
- TOTO BISSAINTHE, grandeur et douleur
- Série « Les voix féminines engagées de la musique traditionnelle » - Épisode 6/6 : Toto Bissainthe, la voix haïtienne d'une exilée révoltée
- En savoir plus sur la Compagnie Les Griots